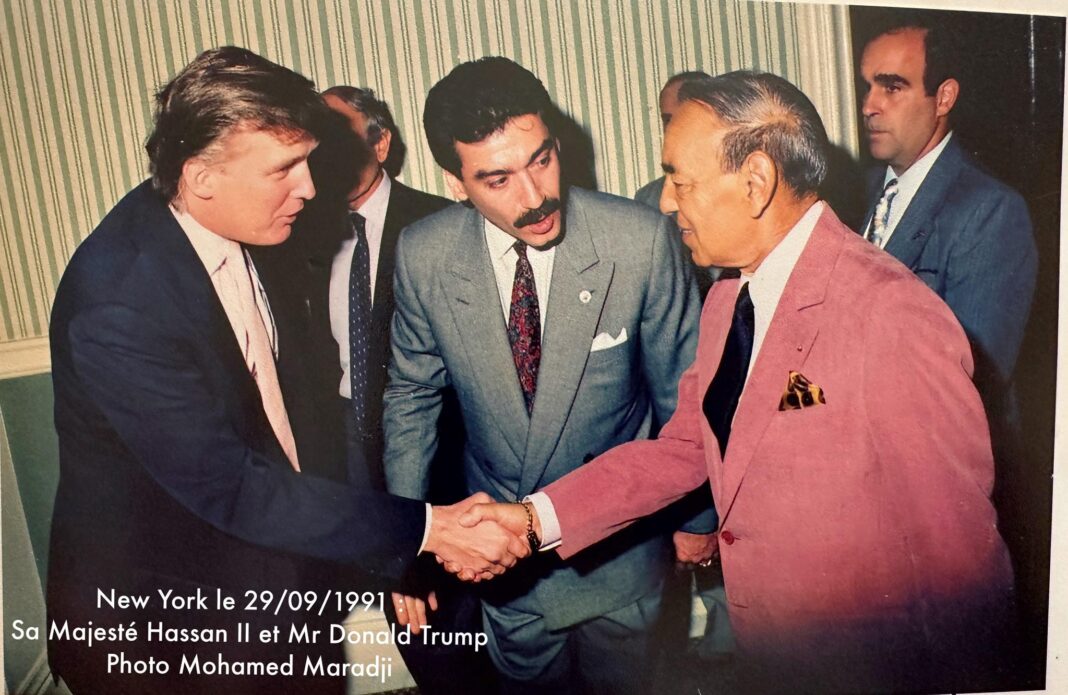Le journal Assahifa a posé une interrogation essentielle, à la fois juridique et morale :
Une question simple en apparence, mais qui résume à elle seule la transformation profonde du dossier du Sahara et le tournant irréversible opéré par la diplomatie internationale depuis l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité.
Une Afrique désormais alignée sur la légalité internationale
Le 31 octobre 2025, lorsque le Conseil de sécurité a adopté la résolution consacrant l’autonomie sous souveraineté marocaine comme la seule base crédible et durable pour une solution politique, trois pays africains siégeaient à la table du vote : la Somalie, la Sierra Leone et l’Algérie. Les deux premiers ont voté pour. L’Algérie, elle, a choisi l’isolement, et s’est retirée de la salle, incapable d’assumer un consensus mondial qu’elle refusait de voir venir.
Ce moment diplomatique, symbolique autant que stratégique, révèle un basculement silencieux : l’Afrique officielle n’est plus celle de 1984.
Près de trois quarts des États africains soutiennent désormais le plan d’autonomie marocain, et 40% disposent de consulats à Laâyoune ou à Dakhla.
L’Union africaine devient ainsi le seul espace institutionnel au monde où survit encore une fiction juridique : celle d’un « État » sans territoire, sans souveraineté, sans reconnaissance.

Une anomalie héritée de la guerre froide
Ce paradoxe remonte à 1984, année où, sous la pression des blocs idéologiques de la guerre froide, l’Organisation de l’unité africaine avait admis dans ses rangs un mouvement séparatiste armé, provoquant le retrait du Maroc, fondateur de cette même organisation. Ce choix, motivé par des considérations politiques plus qu’institutionnelles, a depuis laissé une trace : un vide de légitimité au cœur du système africain.
Lorsque le Maroc a retrouvé son siège en 2016, il ne revenait pas pour «plaider sa cause», mais pour rétablir la vérité juridique et politique. Le Royaume n’a jamais cherché la confrontation : il a préféré la patience, la pédagogie et le travail. Et neuf ans plus tard, les faits lui donnent raison : le Conseil de sécurité parle désormais le langage de Rabat, celui du réalisme, de la stabilité et du respect des souverainetés.
Le moment de vérité pour l’Union africaine
Aujourd’hui, la question n’est plus seulement symbolique. Elle est existentielle pour l’Union africaine elle-même. Comment une organisation continentale, fondée sur les principes d’unité, de paix et d’intégrité territoriale, peut-elle continuer d’abriter en son sein un «membre» non reconnu par les Nations unies, qui prétend ériger un État sur le territoire d’un pays souverain, membre à part entière de l’ONU et de l’Union africaine ?, s’interroge Assahifa.
Le maintien de cette contradiction mine la crédibilité de l’institution africaine. Il la met en porte-à-faux vis-à-vis du droit international, mais aussi vis-à-vis de la majorité de ses membres, qui ont, par leurs actes diplomatiques et économiques, confirmé que le Sahara est marocain de fait et de droit.
Une mise en cohérence inévitable
La diplomatie marocaine, guidée par la vision du Roi Mohammed VI, s’emploie désormais à faire converger le droit continental et le droit international. La question n’est pas celle de l’affrontement, mais celle de la cohérence. Car un continent qui aspire à être une force d’équilibre mondiale ne peut se construire sur un désaccord avec les principes mêmes des Nations unies.
L’Afrique, si elle veut parler d’une seule voix dans le nouvel ordre mondial, devra tôt ou tard corriger cette anomalie institutionnelle.
Le réalisme s’impose, le temps des ambiguïtés s’achève.
Et, comme le souligne Assahifa, la véritable question n’est plus si l’Union africaine agira, mais quand.