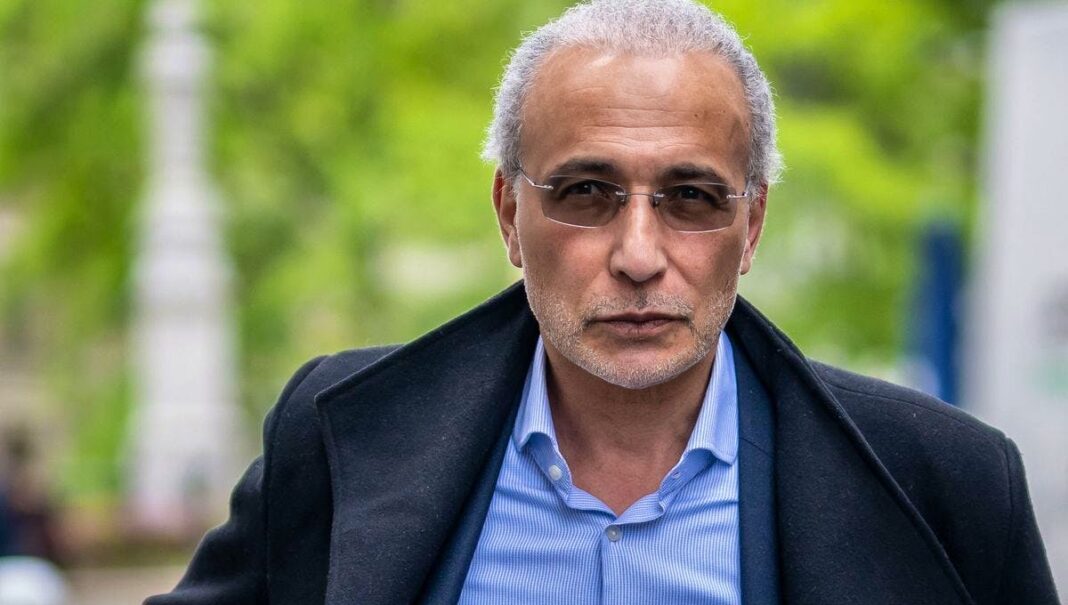Quelques mois à peine après la visite présidentielle d’Emmanuel Macron au Maroc, en octobre 2024, qualifiée d’« historique » et marquée par une réconciliation tant attendue entre deux capitales liées par une histoire singulière, surgissent dans la presse hexagonale des récits à charge, aux accents de ragots, visant directement le Souverain marocain et l’institution monarchique. À cette série d’articles publiés par Le Monde s’ajoute une révélation d’Intelligence Online, organe spécialisé proche de la communauté du renseignement, qui ravive le spectre d’une affaire que l’on croyait définitivement reléguée aux archives des incompréhensions passées.
Une embellie contrariée
Or, chacun sait que Rabat et Paris viennent tout juste de franchir une étape majeure : reconnaissance claire et assumée par la France de la marocanité du Sahara, accueil solennel du président Emmanuel Macron par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la Famille Royale, et signature de vingt-deux accords scellant une « Déclaration de partenariat d’exception renforcé ». À cela s’ajoutent l’annonce de plus de dix milliards d’euros d’engagements économiques, la promesse d’investissements français dans les provinces du Sud et l’ovation recueillie par le discours présidentiel au Parlement réaffirmant la souveraineté marocaine sur le Sahara.
Les gestes symboliques, comme les actes concrets, traduisaient une volonté partagée de dépasser trois années de crispations et d’ouvrir un nouveau cycle stratégique, apaisé et fécond.
Pourquoi alors exhumer des controverses déjà tranchées ? Pourquoi ressasser Pegasus, dossier soldé sur le plan diplomatique, et qui ne devrait plus, à ce stade, encombrer l’horizon d’une relation bilatérale appelée à bâtir l’avenir sur la confiance et la convergence des intérêts ?
Les interrogations d’une séquence médiatique
Le communiqué vigoureux de l’Association Nationale des Médias et des Éditeurs (ANME) au Maroc souligne à quel point la série du Monde dépasse le registre du journalisme pour verser dans la construction d’un narratif hostile. L’ANME y dénonce des « anecdotes fictives », « un ramassis de bobards » et pointe des « agendas occultes » visant à ternir l’image de l’institution monarchique.
De son côté, l’article d’Intelligence Online met en lumière une affaire d’aumônerie militaire où, à défaut de preuves tangibles, plane encore l’ombre du Maroc dans un faisceau d’accusations aussi vagues que persistantes. La Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) y mentionnerait selon les sources du site d’information des « vulnérabilités incompatibles » avec une fonction militaire, en s’appuyant sur de supposés voyages, des liens associatifs ou encore des proximités institutionnelles présentées comme autant de « vecteurs d’influence ».
Or, aucun élément concret ne relie directement l’intéressé à l’affaire Pegasus, et la justice elle-même souligne le caractère lacunaire de ces notes de renseignement, relevant presque du soupçon sans preuve.
Le décalage est saisissant entre, d’un côté, la solennité d’engagements présidentiels et parlementaires qui ont consacré une réconciliation historique entre Rabat et Paris, et, de l’autre, la persistance dans certains cercles de rapports déclassifiés qui, en l’absence de fondements solides, alimentent dans l’opinion publique un climat de suspicion disproportionné.
Une campagne aux arrière-goûts de diversion
Au moment même où la France traverse une crise politico-économique d’une intensité rare — gouvernement fragilisé, déficit public sous surveillance européenne, dette en expansion — et où l’Europe vacille entre incertitudes stratégiques et pression budgétaire, l’on ne peut que s’interroger sur l’opportunité d’entretenir, à coups d’articles sensationnels, un climat de suspicion envers le Maroc.
L’agitation éditoriale, qui exhume des polémiques éteintes ou se nourrit de racontars sans consistance, semble d’autant plus singulière que l’Union européenne elle-même peine à négocier ses relations commerciales avec Washington, à financer son réarmement accéléré et à clarifier sa posture face aux volte-face diplomatiques américaines sur l’Ukraine.
Quant au Royaume-Uni, il se débat avec le spectre médiatique d’un « recours au FMI », reflet d’une inquiétude diffuse sur les marchés. Dans une Europe en proie à ses propres turbulences, la réactivation de tensions bilatérales avec un pays du sud paraît davantage relever d’un bruit de fond que d’une priorité stratégique, comme si l’on projetait vers l’extérieur des incertitudes d’abord européennes.
Une relation à préserver
Faut-il voir dans cette simultanéité une simple coïncidence, ou les traces de résistances au sein de cercles qui redoutent le retour à la confiance entre Rabat et Paris ? Les vieilles habitudes, les réflexes d’une époque révolue, ressurgissent-ils pour parasiter une dynamique que les plus hautes autorités des deux pays ont pourtant scellée ?
Ce qui est certain, c’est que le Maroc comme la France ont beaucoup à perdre à laisser prospérer ces interférences. Le partenariat entre les deux nations ne saurait se limiter à des cycles d’enthousiasme et de suspicion : il est appelé à se projeter vers l’avenir, qu’il s’agisse de sécurité, d’investissements, de jeunesse ou de transition énergétique, autant de chantiers où l’alliance franco-marocaine demeure indispensable.
Au moment où un « nouveau livre » vient d’être ouvert, les tentatives de brouiller son introduction par des récits à charge ou des révélations déclassifiées appellent à la vigilance. Mais elles ne doivent pas détourner l’essentiel : la France et le Maroc, liés par l’histoire et tournés ensemble vers l’avenir, ont tout à gagner dans la consolidation de leur partenariat.