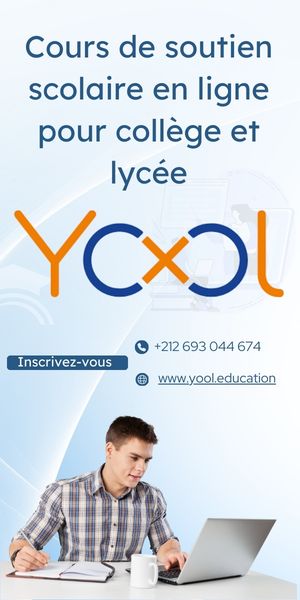Le 20 décembre 2023, Emmanuel Macron mettait fin à une séquence douloureuse du renseignement français en nommant Nicolas Lerner à la tête de la DGSE. L’ancien patron de la DGSI, préfet formé à l’ENA et proche du chef de l’État, succédait à Bernard Émié, diplomate au long cours, devenu symbole d’une DGSE fragilisée : incapable d’anticiper l’invasion de l’Ukraine, aveugle aux coups d’État sahéliens, muette face aux percées russes en Afrique comme sur le sol français. Le Canard enchaîné, cruel mais lucide, parlait alors des « blaireaux des légendes ».
En plaçant un homme du contre-espionnage à la tête du service, l’exécutif redessinait un axe clair : retour à la méthode, resserrement de la chaîne de commandement, recentrage sur l’efficacité opérationnelle. L’entretien exceptionnel accordé par Nicolas Lerner à LCI, une première dans l’histoire des services extérieurs français, n’est pas seulement un geste de transparence. Il est un acte politique, un signal à l’opinion, mais aussi un message adressé aux services rivaux : la maison est debout, le renseignement français s’est réarmé, et le centre de gravité stratégique a changé de main.
La DGSE, un service universel, intégré et en expansion
Événement télévisé sans précédent, l’entretien de 51 minutes accordé par Nicolas Lerner, Directeur Général de la DGSE, à LCI le 8 juillet 2025, marque un tournant dans la manière dont la France conçoit la transparence en matière de renseignement. Sous des dehors calmes, pesés, le chef des services extérieurs français livre une série de messages à fort contenu stratégique. À l’heure des menaces hybrides et des suspicions sur les services, Lerner expose à la fois une doctrine, un style, et une mise en garde.
S’exprimant depuis le centre de commandement du «quartier fermé» du siège à Paris, Nicolas Lerner décrit une DGSE moderne, plus nombreuse et agile. Il vante une efficacité discrète, tout en mettant en scène un haut niveau de sécurité : téléphones bannis, salles «dépoussiérées», solutions technologiques maison, murs insonorisés.
Nicolas Lerner a souligné la spécificité du modèle français : un service intégré rassemblant renseignement humain, technique, contre-espionnage et action clandestine, à la différence des structures cloisonnées d’autres pays. La DGSE agit à vocation globale, comme la CIA ou le MI6, avec plus de 7 500 agents, service Action compris – chiffre public, hors effecteurs et sources.
Depuis 2017, sous les quinquennats d’Emmanuel Macron, les moyens de la DGSE ont été renforcés massivement, avec +1100 agents et encore 500 recrutements prévus.
Ennemi n°1 : la Russie
La Russie de Vladimir Poutine est au cœur du propos de Nicolas Lerner. Le chef de la DGSE décrit une menace stratégique à long terme, portée par une idéologie à double tranchant : une paranoïa défensive — le sentiment d’être encerclé par des démocraties hostiles — et une nostalgie impériale, nourrie par l’idée que « la Russie sera empire ou ne sera pas ». Cette double matrice sert de socle à une justification idéologique de la guerre préventive.
Mais l’alerte ne se limite pas au champ doctrinal. La France a été lourdement infiltrée par les services russes avant 2022 : près de 80 agents d’espionnage identifiés sur le territoire, dont 50 ont été expulsés. Depuis, le mode opératoire a évolué : Moscou agit désormais par proxies, en rémunérant des intermédiaires locaux — souvent recrutés dans des milieux économiques perméables — pour mener des actions clandestines.
Lerner illustre cette menace hybride par une affaire de contre-espionnage révélée en 2022 : un cadre français, haut placé, était payé depuis plus d’une décennie par les services russes, pour un montant mensuel deux à trois fois supérieur au salaire médian. Le but : obtenir un accès stratégique et durable. Pour la DGSE, c’est une démonstration claire que le renseignement adverse travaille dans la profondeur, sur le temps long.
Aujourd’hui, les opérations d’ingérence se multiplient : campagnes informationnelles, manipulations numériques, sabotages symboliques et actions physiques sur le sol national. Lerner confirme une ingérence russe active en France, avec une nouvelle dynamique : le couplage d’actions cyber et de manœuvres sur le terrain. Comme il le souligne, « le chef de l’État russe assume qu’il a, au moment où nous parlons, des agents clandestins dans les capitales occidentales ». À cette guerre discrète, la France répond par la discrétion organisée : adaptation, détection, neutralisation — parfois en silence.
Iran, Algérie : une diplomatie du renseignement
Sur le dossier iranien, Lerner révèle que la France n’avait pas été avertie du bombardement américain sur Fordow, confirmant l’ampleur du désalignement stratégique avec Washington. Malgré cela, il salue la coopération technique avec la CIA, notamment dans la lutte antiterroriste.
Avec Moscou comme avec Alger, le canal renseignement subsiste quand la diplomatie chancelle. La DGSE parle à presque tous les services du monde — même ceux dits “adverses”. Une doctrine de canaux permanents.
Mais un changement est en cours : les Américains, sous Trump, se recentrent sur leurs priorités domestiques. Comme pour la Défense, l’Europe doit apprendre à « faire plus », aussi dans le domaine du renseignement. Un état de fait qui renforce la posture voulue par le maître-espion français.
Le renseignement humain face aux régimes fermés
Russes, Iraniens, Nord-Coréens : autant de régimes où l’accès à l’information stratégique repose sur quelques mains, ce qui rend la pénétration difficile. L’objectif reste d’avoir des sources au plus près du pouvoir, mais Lerner reconnaît la complexité de cette mission « à la Farewell ». Il n’exclut pas les agents doubles, mais rappelle que ces opérations se mènent dans le temps long, loin des projecteurs.
Le cas Dourov : une contre-offensive narrative
Accusé publiquement par Pavel Dourov, fondateur de Telegram, de tentative de censure ciblée sur des comptes conservateurs roumains, Nicolas Lerner a choisi de démentir immédiatement. Il confirme la rencontre, mais conteste toute pression ou intrusion politique. Il réfute aussi avoir effectué un déplacement en Roumanie comme le prétendait Dourov, preuve à l’appui. Pour la DGSE, cette affaire est emblématique d’une époque où la guerre informationnelle vise aussi la crédibilité des services. La réaction rapide et publique est un signal : la DGSE n’entend pas se laisser piéger sur le terrain de la post-vérité.
Une déclaration qui a poussé l’émission Thinkerview, réputée pour sa proximité avec la communauté des renseignements, à demander une réaction du fondateur sur Telegram.
Le cas Biper : l’admirable brutalité du Mossad
Interrogé sur l’opération «Biper», menée par le Mossad contre le Hezbollah, Lerner analyse avec prudence un coup d’éclat technico-opérationnel. L’opération, mêlant infiltration humaine, innovation technologique et frappe massive, incarne pour lui l’excellence d’un grand service. Mais il en tire aussi une leçon : celle du risque d’hubris. Citant le livre Lève-toi et tue le premier, il rappelle que l’efficacité tactique ne doit jamais conduire à l’oubli de la stratégie politique. La diplomatie doit être la finalité du renseignement, non sa défaite.
Morale d’espion : manipuler, mais ne pas déraper
Le DG revient longuement sur la culture interne de son service. Un bon espion ? «Malin, curieux, manipulateur, prudent». Il évoque les fameuses “4M” du recrutement : Money, Morality, Mesmer, Motive. Il assume l’idée de faire trahir un pays étranger pour défendre la France, à condition de ne jamais agir hors du cadre.
La DGSE comme contre-pouvoir discret
À ceux qui redoutent un « État profond » à la française, la DGSE se veut irréprochable : transparence interne, service de sécurité, refus des dérives politiques. Il n’existe pas de fiches politiques, pas de surveillance occulte des candidats, affirme son DG. L’État de droit encadre le renseignement, et même les lanceurs d’alerte internes sont prévus par la loi.
Lerner oppose la transparence juridique et rappelle que toute écoute est encadrée par la loi de 2015, validée par une commission indépendante, et que tout Français peut saisir la CNIL. Une contre-offensive contre les soupçons.
Et un point que les Français ignorent : n’importe quel Français peut saisir la DGSE, peut saisir la CNIL — la Commission nationale informatique et libertés — pour demander s’il fait l’objet d’un fichage. Et la CNIL aura l’obligation — et nous aurons l’obligation — de mettre à disposition nos fichiers. La CNIL vérifiera si l’éventuel fichage de tel intéressé est légitime ou pas.
Le terrorisme islamiste, seule constante du renseignement international
Dans un monde où les lignes diplomatiques se brisent plus vite qu’elles ne se réparent, une seule menace continue de fédérer les services de renseignement, quels que soient leurs régimes, leurs doctrines ou leurs conflits : le terrorisme islamiste. Nicolas Lerner le dit sans détour : « Il y a un domaine qui ne souffre pratiquement pas d’exception, sur lequel on n’est pas dans une logique de donnant-donnant, c’est le terrorisme islamiste. » Que les relations soient gelées ou hostiles, le canal opérationnel reste ouvert, car l’enjeu est vital.
En 2024, neuf projets d’attentats ont été déjoués. La DGSE reste en alerte maximale. La menace, elle, se transforme : radicalisation individuelle fulgurante, mais aussi projets organisés, concertés, structurant des actions violentes. Les inspirés côtoient les complotants, les jeunes solitaires de 12 ou 13 ans rejoints parfois par des réseaux plus structurés. Face à cela, la coopération prévaut, même avec des régimes autoritaires. Dès lors que la vie humaine est en jeu, les échanges sont immédiats, les priorités partagées, les rivalités suspendues.
Lerner le confie sans détour : « Ma hantise, c’est de ne pas voir venir. Et de rater. »
L’intelligence artificielle et les dérisions de l’omniscience
Malgré la puissance des outils numériques, la DGSE reste ancrée dans une humilité opérationnelle. Trop de données tuent l’information. L’IA n’est pas là pour tout aspirer, mais pour aider à trier. L’enjeu n’est pas de ficher toute la société, mais de cibler, de comprendre, d’anticiper. L’esprit reste premier.
Vers une nouvelle doctrine du renseignement français
En s’exprimant publiquement dans un format télévisuel grand public inhabituel, Nicolas Lerner n’a pas cherché à incarner un pouvoir personnel, mais à clarifier une ligne de fonctionnement. Sans emphase, il rappelle que l’action du renseignement repose d’abord sur une posture de prudence, de vigilance et de loyauté à l’égard des institutions. Loin des représentations fantasmées, l’espionnage reste pour lui un métier encadré, technique, régi par le droit et orienté vers une finalité unique : la protection des intérêts nationaux.
Cette prise de parole s’inscrit dans un contexte particulier : celui d’une DGSE renforcée sur le plan opérationnel, dotée de moyens élargis, adossée à une chaîne de commandement cohérente entre l’Élysée, le ministère des Armées et la direction du Service, et de plus en plus associée aux grandes orientations diplomatiques de la France. Une DGSE qui assume sa spécificité française : articuler renseignement extérieur, souveraineté nationale et responsabilité démocratique.
Nicolas Lerner reconnaît que, dans ce domaine, la frontière entre coopération et rivalité reste mouvante, y compris entre alliés. Mais il revendique une ligne claire : efficacité, oui ; dérives, non. Le service ne s’affranchit ni du droit, ni du contrôle politique.
Cet entretien marque donc moins une rupture qu’une évolution méthodique : la volonté d’assumer une forme de lisibilité stratégique, dans un monde où le champ informationnel est devenu un théâtre d’affrontement à part entière.