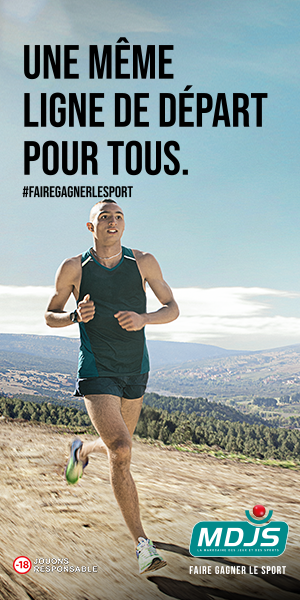En 2015, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a fait une demande audacieuse et inhabituelle au président chinois Xi Jinping : celle de «lui faire l’honneur» de nommer son enfant à naître. Cette anecdote, aussi étrange qu’évocatrice, est révélée par Sarah Wynn-Williams, ancienne directrice mondiale des politiques publiques de Facebook, dans son mémoire explosif Careless People.
La réponse de Xi ? Un refus catégorique. Cet épisode, loin d’être anodin, illustre l’obsession de Zuckerberg pour conquérir le marché chinois – une «baleine blanche» de 1,4 milliard d’habitants qui lui échappe encore. Mais derrière cette demande insolite se cache une histoire bien plus vaste : celle d’une entreprise, Meta, et de ses dirigeants, dépeints comme des «enfants capricieux» ivres de pouvoir, dans un récit qui secoue Silicon Valley depuis sa sortie le 15 mars 2025.
Une tentative désespérée pour séduire la Chine
La demande à Xi Jinping n’était pas un simple caprice. Selon Wynn-Williams, qui a travaillé chez Facebook de 2011 à 2017, elle s’inscrivait dans une stratégie plus large pour pénétrer le marché chinois, interdit à la plateforme depuis 2009. Zuckerberg, déterminé à faire de la Chine son prochain triomphe, a multiplié les gestes de bonne volonté envers le Parti communiste. Parmi eux : des promesses de promouvoir «l’ordre social», le partage de détails sur la technologie de reconnaissance faciale de Facebook avec des ingénieurs chinois, et même une offre de censure proactive. Wynn-Williams raconte comment l’entreprise a proposé au gouvernement chinois une liste noire de contenus à bloquer, installant des “compteurs de viralité” à Hong Kong et à Taïwan pour tester ces mécanismes. Pourtant, malgré ces efforts, la Chine reste hors de portée. Meta ne nie pas son intérêt : en 2024, elle a généré 18 milliards de livres sterling de revenus grâce aux entreprises chinoises annonçant sur ses plateformes, sans pour autant opérer directement dans le pays.
Careless People : un livre qui dérange
Publié au Royaume-Uni par Macmillan malgré une injonction temporaire obtenue par Meta aux États-Unis, Careless People est bien plus qu’un recueil d’anecdotes. Sarah Wynn-Williams, qui vit aujourd’hui à Londres avec son mari Tom Braithwaite, éditeur au Financial Times, et leurs trois enfants, y livre une critique acérée de ses six années au sein de «l’inner sanctum» de Facebook. Le titre, inspiré des personnages irresponsables de Gatsby le Magnifique, vise directement Zuckerberg et Sheryl Sandberg, l’ancienne directrice des opérations. Le livre, qui a atteint la 4e place des best-sellers imprimés sur Amazon en quelques jours, est à la fois un témoignage personnel et un réquisitoire contre une culture d’entreprise marquée par le népotisme, l’absence de responsabilité et une soif de pouvoir démesurée.
Meta, maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a réagi avec virulence. L’entreprise qualifie le livre de «mélange d’allégations diffamatoires et fausses» et de «revendications dépassées», dépeignant Wynn-Williams comme une ex-employée «licenciée pour mauvaise performance et comportement toxique». Une version contestée par l’auteure, qui insiste : elle ne cherche pas la vengeance, mais à «laisser entrer la lumière» sur les pratiques opaques de l’entreprise. Écrit dans le plus grand secret – même sa mère n’était pas au courant –, le livre a été conçu comme une bombe à retardement, et Meta le sait.

Zuckerberg et Sandberg : un duo dans une bulle opaque
Wynn-Williams dresse un portrait sans concession de Zuckerberg, qu’elle décrit comme un mélange d’adolescent boudeur et de toddler ( gamin) capricieux. Réticent à se lever avant midi, même pour rencontrer des premiers ministres, il exigeait que ses collègues le laissent gagner aux jeux de société. Lorsqu’en 2016 Barack Obama l’a réprimandé pour le rôle de Facebook dans la propagation de fake news pendant l’élection présidentielle, Zuckerberg a réagi par une colère puérile : «Il n’y comprend rien, il se trompe complètement.» Pourtant, sur un jet privé la même année, il a fini par admettre, sous la pression de son équipe, que la plateforme avait aidé à faire élire Donald Trump – un sujet brûlant qu’il avait d’abord qualifié de «dingue».
Sheryl Sandberg, quant à elle, est loin de l’image de féministe irréprochable véhiculée par son best-seller Lean In. Wynn-Williams révèle des comportements troublants : une invitation ambiguë à partager un lit lors d’un vol privé (refusée, suivie d’un ostracisme), ou encore une relation intime avec une assistante de 26 ans, impliquant des achats de lingerie à 13 000 dollars et des échanges sur leurs corps. «Les règles ne s’appliquent pas», commente Wynn-Williams, soulignant un entourage «d’enablers» et une expression brute de pouvoir. Sandberg, dont les subordonnés directs étaient majoritairement masculins, apparaît comme une figure hypocrite, loin de son discours d’émancipation.

ANDREW GOMBERT/EPA/SHUTTERSTOCK
Meta : Une culture d’entreprise toxique
Au-delà des deux têtes d’affiche, Wynn-Williams dénonce une culture interne où règnent l’élitisme et le népotisme. «Tout le monde semblait sortir de Harvard», note-t-elle, décrivant un réseau fermé où collègues se mariaient, s’achetaient des maisons et se soutenaient dans une bulle «opaque». Cette opacité empêchait Zuckerberg et Sandberg de voir le monde extérieur, les isolant dans un cocon de jets privés et de privilèges. L’auteure compare son départ de l’entreprise à une sortie de secte, un sentiment renforcé par le manque d’éthique qu’elle a observé.
Parmi les exemples marquants : en 2014, enceinte, elle a été envoyée au cœur de l’épidémie de Zika ; en 2016, un collègue, Diego Dzodan, a été arrêté au Brésil pour le refus de WhatsApp de livrer des données, tandis que Zuckerberg voulait en faire un «post réconfortant» sans égard pour sa défense. «Comment avons-nous encore des soldats sacrifiables dans l’Amérique corporative ?» s’interroge-t-elle.
Les scandales qui ont marqué son parcours
L’élection de Trump en 2016 est un tournant. Wynn-Williams révèle que des employés de Facebook étaient intégrés à la campagne de Trump, enseignant comment exploiter la plateforme – une aide refusée par Hillary Clinton. «Vous dirigez une entreprise basée sur l’idée de changer la marque de dentifrice que quelqu’un achète, et vous êtes surpris par ça ?» ironise-t-elle. Un autre scandale majeur concerne Myanmar en 2018 : la plateforme, quasi-synonyme d’internet dans le pays, a amplifié les discours de haine contre les Rohingya, contribuant à un massacre de 25 000 personnes. Meta a admis avoir été «trop lente à réagir».

Un départ brutal et un appel à l’éthique
Licenciée en 2017 après avoir dénoncé un harcèlement sexuel par son supérieur Joel Kaplan (aujourd’hui à la tête des affaires globales chez Meta), Wynn-Williams décrit son éviction comme une «euthanasie rapide». Meta rejette ces accusations comme «infondées», affirmant que Kaplan a été blanchi. Pour elle, ce fut un mélange de terreur – «ma carrière était-elle finie ?» – et de soulagement face à une entreprise où elle ne trouvait plus de «ligne éthique infranchissable».
Aujourd’hui consultante technologique, elle appelle à tirer les leçons de Facebook pour l’ère de l’IA, qu’elle voit comme une menace encore plus grande, intégrée dans des armes et concentrant un pouvoir «insondable». Ironie du sort : elle reste «amie» avec Zuckerberg, Sandberg et Kaplan sur Facebook, ajoutant avec un haussement d’épaules : «Quoi que cela veuille dire.»
Une voix parmi d’autres ?
Wynn-Williams n’est pas la première lanceuse d’alerte de Facebook, mais elle est la première à avoir appartenu à son cercle intime. Elle interpelle aussi Nick Clegg, ex-dirigeant de Meta (2018-?), qui a empoché plus de 100 millions de livres sterling, à «dire la vérité». Quant à Zuckerberg, son récent virage – don à l’inauguration de Trump, moins d’efforts pour apaiser les critiques – montre, selon elle, une absence de valeurs autres que l’argent. “Ils n’ont pas d’amitiés comme vous et moi”, dit-elle, entourés de loyaux dépendants financièrement.
Alors que les milliardaires technologiques, comme Elon Musk, s’impliquent davantage en politique, Wynn-Williams prévient : «Nous ne sommes qu’au début d’une fusion entre tech et pouvoir politique.» Son livre, déjà un succès, pourrait bien être le premier coup de semonce.