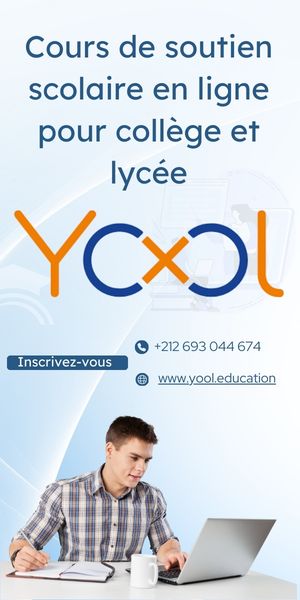Dans une année électorale marquée par une montée d’incertitude politique, le Maroc affronte simultanément une impatience citoyenne accrue et une érosion visible de la confiance envers une partie de la classe politique. L’épisode GenZ a révélé la vulnérabilité d’un paysage partisan où plus de trente députés et cinq cents élus sont poursuivis ou condamnés pour corruption ou détournement de fonds. Un choc institutionnel qui fragilise les mécanismes classiques de la reddition démocratique. À cela s’ajoute un retard d’exécution de certains projets publics, qui renforce la fracture d’un pays que le Souverain refuse de voir avancer « à deux vitesses », un pays parfois soumis à ces « rythmes circadiens » – expression empruntée du livre « le temps du Maroc » de l’auteur Abdelmalek Alaoui – où accélérations brutales et phases d’attente se succèdent, rendant d’autant plus urgente la nécessité d’une trajectoire territoriale cohérente.
Les Hautes Orientations Royales, rappelées à la fois lors du Discours du Trône et à l’ouverture de la session parlementaire, insistent sur la justice territoriale, la valorisation des spécificités locales, la réduction des écarts sociaux, la gestion durable de l’eau et la consolidation de la régionalisation avancée comme leviers stratégiques d’un développement profondément intégré. Elles s’inscrivent également dans l’exigence nationale d’accompagner le chantier structurant de l’autonomie au Sahara, qui requiert une architecture de gouvernance cohérente, mieux coordonnée et fondée sur des mécanismes de pilotage et de suivi plus robustes.
Dans ce contexte : calendrier électorale, attentes citoyennes, engagements internationaux et organisation de grands événements de visibilité planétaire, la démarche du ministère de l’Intérieur, sous la responsabilité d’Abdelouafi Laftit, apparaît pour certains comme une structure de stabilisation et de synchronisation territoriale, quand d’autres y voient une dévitalisation de la régionalisation ou une recentralisation bureaucratique ( cf le Desk ). Reste une question centrale : la conjoncture laisse-t-elle réellement d’autres options, lorsque la majorité gouvernementale fragilisée gère désormais les affaires courantes, que la carte politique demeure éclatée et que le calendrier impose ses contraintes ? Et quels garde-fous ont été institués pour garantir la cohérence constitutionnelle, dans un moment où l’idée d’un ajustement de la Constitution refait surface ?
Début novembre 2025, le ministère de l’Intérieur a lancé une vaste série de consultations nationales consacrées au développement territorial intégré. Ces rencontres, organisées dans l’ensemble des soixante-quinze provinces du Royaume, ont pour vocation de recueillir les besoins réels des citoyens, de mobiliser l’intelligence collective locale et d’esquisser des programmes territoriaux, à la fois réalistes, participatifs et alignés sur les Hautes Orientations Royales.
Cette démarche, qui s’inscrit dans la nouvelle génération des programmes de développement territorial ( PDTI ), s’appuie sur une ingénierie de concertation décentralisée et sur la mise en place d’une plateforme numérique dédiée au suivi, à l’évaluation et à la convergence des projets. Elle marque une volonté claire : replacer le territoire au centre de la décision publique et rétablir une cohérence entre aspirations locales et trajectoires nationales.
Au Maroc, la question du développement territorial n’est plus celle du partage du pouvoir, mais celle de la cohérence des dynamiques. Le pays a franchi le cap des réformes institutionnelles, il entre dans celui de la cohérence opérationnelle. Derrière le sigle technocratique de PDTI – Programmes de Développement Territorial Intégré – se dessine en réalité une refondation silencieuse : celle d’un État qui réapprend à articuler les échelles, à conjuguer proximité et vision d’ensemble, et à faire du territoire non plus un découpage administratif, mais une matrice d’équilibres et d’opportunités.
Cette nouvelle génération de programmes s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales qui placent la cohésion et l’équité territoriale au cœur des priorités nationales. « Il n’y a de place ni aujourd’hui ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses », a rappelé le Roi, assignant à l’action publique une finalité claire : faire converger les territoires, renforcer la justice spatiale et ancrer la solidarité entre les composantes du Royaume.
C’est dans cet esprit que le ministère de l’Intérieur déploie aujourd’hui une approche plus intégrée, pensée pour prévenir l’apparition de nouvelles fractures et accompagner les dynamiques nationales dans une trajectoire plus cohérente et plus inclusive.
I. Le dépassement des anciens schémas
Le Maroc ne pouvait demeurer dans un modèle où des régions prospères avancent tandis que d’autres s’enlisent. Les directives royales invitent à passer d’une logique exclusivement sectorielle à une logique territoriale intégrée, fondée sur la complémentarité entre les entités territoriales, la valorisation des spécificités locales et une meilleure synchronisation des interventions publiques.
Le développement n’est plus pensé en termes de compétition institutionnelle, mais d’équité effective. La régionalisation avancée n’est pas abandonnée, elle est réinscrite dans un cadre plus large : celui d’une cohérence nationale portée par la solidarité et la convergence.
Dans cette logique, la proximité ne se mesure plus à la distance au pouvoir central, mais à la capacité d’un territoire à produire, à coopérer et à redistribuer.
II. Une nouvelle architecture de la gouvernance territoriale
La réforme ne vise pas la centralisation, mais la synchronisation des politiques publiques. Là où les anciennes approches juxtaposaient les programmes régionaux, communaux ou sectoriels, le PDTI propose une architecture polycentrique, où les comités préfectoraux et provinciaux deviennent les ateliers stratégiques de la décision publique.
Les walis et gouverneurs ne sont pas les substituts du politique, mais les garants de la cohérence territoriale, conformément aux discours royaux qui soulignent l’importance de la complémentarité entre les échelons et la déconcentration de l’exécution. Leurs missions consistent à harmoniser les interventions, à éviter la duplication des projets, à assurer la mutualisation des ressources et à organiser la concertation locale.
Cette gouvernance repose sur des principes clairs : transparence, proximité, agilité, contrats-objectifs territoriaux, indicateurs d’impact et obligation de résultats. La régionalisation avancée trouve ainsi un prolongement pragmatique : elle devient opératoire.
III. Le territoire comme espace d’intelligence collective
Les Hautes Orientations Royales insistent sur la nécessité d’une approche participative, nourrie par la collecte de données précises, par le diagnostic territorial et par l’écoute des citoyens. Le PDTI épouse cette philosophie en faisant du territoire une unité d’intelligence collective.
Les consultations lancées dans toutes les provinces mobilisent élus, acteurs économiques, services déconcentrés, société civile. Loin d’une dévitalisation, cette méthode ré-ancre la planification dans la vie concrète :
- précarités des zones montagneuses et oasis,
- gestion durable du littoral,
- développement des centres ruraux émergents,
- sécurité hydrique et gestion proactive des ressources,
- renforcement de l’éducation et de la santé,
- dynamisation de l’emploi territorial.
La province et la préfecture deviennent ainsi des espaces de réalité et de nuance, où se croisent les besoins immédiats, les vulnérabilités structurelles et les trajectoires économiques émergentes.
IV. La convergence plutôt que la compétition
La philosophie du PDTI, comme elle a été expliquée, consacre une idée simple : le Maroc n’a pas besoin de régions concurrentes, mais de territoires complémentaires, capables d’aligner leurs efforts sur les grandes orientations nationales. Chaque région doit tirer parti de ses vocations, non pour s’isoler, mais pour renforcer la solidité de l’ensemble du pays.
La convergence devient la colonne vertébrale de la politique territoriale. Elle neutralise la fragmentation, fluidifie les chaînes de décision et garantit que les effets de la croissance irriguent les zones les plus vulnérables. C’est dans cette logique que le Souverain a rappelé l’impératif de la solidarité, de la justice territoriale et de la cohésion.
V. L’État stratège et la maturité territoriale
Le Maroc expérimente aujourd’hui une forme avancée d’État stratège. Loin de reprendre la main pour la garder, il exerce une fonction d’articulation : il garantit la cohérence des trajectoires locales, l’équilibre des politiques et la soutenabilité des interventions.
Cette approche marque-t-elle un retour au verticalisme, un interventionnisme imposé par la conjoncture, ou au contraire l’expression d’une maturation institutionnelle ? À l’examen, elle semble surtout traduire la volonté de doter le territoire d’un cadre de gouvernance où la redevabilité devient partagée : l’administration répond de ses résultats, les élus de leur légitimité, et les territoires de leur performance.
VI. Pour une progression territoriale disciplinée et soutenable
Ce basculement silencieux est celui d’un Maroc en train d’assumer pleinement sa transition vers une gouvernance intégrée, où la cohérence territoriale prime sur les rivalités institutionnelles. Le PDTI parachève l’esprit de la régionalisation avancée : un pays qui accepte sa diversité tout en rendant ses territoires interdépendants, solidaires et alignés sur une même trajectoire de cohésion nationale.
L’horizon 2035, souvent évoqué comme une ligne directrice des grandes réformes, ne relève plus d’un futur hypothétique. Il s’affirme jour après jour comme un repère structurant, autour duquel se synchronisent choix politiques, investissements publics et transformations sociales.
Pour franchir cette étape, le Maroc devra toutefois dépasser ces « rythmes circadiens », ces cycles irréguliers qui, au fil des décennies, ont alterné accélérations impressionnantes et temps d’arrêt prolongés. Cette alternance a permis des percées décisives, mais elle a parfois freiné l’installation d’une dynamique continue et lisible.
Il serait également illusoire d’ignorer la part de responsabilité qui incombe aux acteurs politiques. Depuis 2016, la montée en compétences attendue des régions n’a pas suivi le rythme des ambitions affichées, ni sur le plan de l’ingénierie, ni sur celui de la coordination institutionnelle. Cette réalité limite la portée des critiques adressées aujourd’hui à l’État et renvoie partis et élus à leur propre devoir de consolidation territoriale : sans capacités locales affirmées, aucune décentralisation ne peut devenir pleinement opérationnelle, et aucune gouvernance territoriale ne peut prétendre à la maturité.
Le défi consiste désormais à instaurer une progression stable et disciplinée, où la continuité de l’action publique devienne un atout stratégique : une manière de renforcer la confiance des citoyens, de sécuriser les décisions des investisseurs et d’offrir à nos partenaires étrangers la visibilité nécessaire à des alliances durables.
C’est dans cette constance que peut se déployer, à l’horizon 2035, un Maroc pleinement puissance-pivot, porté par une architecture territoriale plus soutenable, une cohésion renforcée et une capacité accrue à transformer chaque territoire en levier d’avenir.
PDTI : Les fondamentaux du Programme de Développement Territorial Intégré
Définition
Les Programmes de Développement Territorial Intégré (PDTI) constituent la nouvelle génération de politiques territoriales, fondée sur les Hautes Orientations Royales.
Ils visent à réduire les disparités, renforcer la convergence, et ancrer la justice territoriale en articulant les échelons régionaux, préfectoraux et provinciaux.
Objectifs stratégiques
➕ Assurer qu’aucun territoire ne reste en marge des dynamiques nationales (fin du Maroc « à deux vitesses »).
➕ Valoriser les spécificités locales et les vocations de chaque bassin territorial.
➕ Synchroniser les interventions sectorielles dans un cadre intégré.
➕ Consolider la régionalisation avancée en la rendant opérationnelle et mesurable.
➕ Adapter la gouvernance territoriale aux exigences du chantier de l’autonomie au Sahara.
Principes directeurs
➕ Convergence territoriale et complémentarité entre acteurs.
➕ Planification intégrée reposant sur le diagnostic territorial et les données.
➕ Participation des élus, services déconcentrés, acteurs économiques et société civile.
➕ Gouvernance agile et transparente, orientée résultats et impacts.
➕ Contrats-objectifs territoriaux, indicateurs d’évaluation et suivi continu.
➕ Priorité aux zones montagneuses, oasis, littorales, aux centres ruraux émergents, et aux défis de l’eau.
Rôle des walis et gouverneurs
Coordinateurs de la cohérence territoriale, garants de la convergence des politiques publiques et de la mutualisation des efforts.