Alors que Donald Trump a conditionné ses négociations commerciales avec la Chine au contrôle de TikTok sur le sol américain, et que l’Égypte, fidèle à sa méthode répressive, a emprisonné ses trente influenceurs les plus suivis pour mieux remettre la plateforme sous la coupe des services de renseignement militaires dirigés par le fils d’Al-Sissi, le Maroc semble reproduire les erreurs commises avec Facebook en 2011 et Twitter en 2017 : absence de vision, absence de stratégie, absence d’anticipation.
Relire : Al-Sissi verrouille TikTok, nouveau front de la guerre médiatique en Égypte
Les leçons oubliées de Facebook et X/Twitter
Ces réseaux n’étaient pas de simples plateformes de divertissement. Facebook a servi de catalyseur aux Printemps arabes comme aux révolutions colorées en Europe de l’Est. Twitter, de son côté, avait revendiqué sans détour la chute des dirigeants comme objectif, au nom d’une liberté d’expression brandie comme étendard. Trump lui-même en a payé le prix fort. Les révélations des Twitter Files, qui ont éclaté après l’arrivée de Musk, ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient : derrière l’apparente neutralité technologique se cachait une ingénierie géopolitique assumée et une idéologie woke soutenue et financée par de puissant cercles d’influence.
En tournant le dos à ces espaces numériques, le Maroc a laissé se former des vides informationnels exploités par d’autres. Certes, le Royaume a progressivement repris le contrôle de Facebook et de Twitter, preuve d’une capacité d’adaptation et de résilience de ses institutions. Mais ce rééquilibrage n’a pas été sans coût : fractures sociales, crispations politiques et pertes économiques sont venues rappeler que le prix du retard est toujours élevé.
Aujourd’hui, TikTok représente une nouvelle frontière, et le pays risque de répéter ce schéma s’il ne s’y engage pas à temps.
TikTok : l’arme culturelle et politique de la Gen Z
Contrairement à Facebook ou X/Twitter, TikTok n’est pas cantonné à une élite sociale lettrée. Il a pénétré tous les foyers sans exception grâce à son accessibilité et à la puissance de son algorithme. Surtout, il se distingue par une esthétique brute, souvent trash, qui déjoue les codes policés d’Instagram. Là où les autres réseaux filtraient, TikTok expose sans fard — misère, absurdités et provocation. Un registre qui, au Maroc, rappelle l’avance prise par une chaîne comme ChoufTV, qui avait déjà fait de la crudité un produit d’appel.
Là réside la force – et le danger – de TikTok : une plateforme où l’on peut monétiser la bêtise, la dérision et la marginalité, et qui, de ce fait, touche directement la jeunesse la plus vulnérable.
Une bataille mondiale pour un algorithme
Aux États-Unis, le débat autour de TikTok a pris une tournure stratégique. Selon les révélations du Financial Times, Washington et Pékin ont trouvé un compromis inédit : l’application américaine utilisera l’algorithme chinois de ByteDance, mais sera entraînée sur des données locales. Autrement dit, l’algorithme – cœur de la machine, clé de la viralité – reste une technologie chinoise, concédée sous licence. Pékin revendique même l’exportation de son savoir-faire comme un symbole de puissance technologique.
Cette bataille dépasse largement le champ numérique. Elle cristallise la confrontation entre souveraineté technologique, influence culturelle et sécurité nationale. Pour les Américains, la crainte est claire : que l’algorithme soit manipulé pour diffuser propagande ou contenus polarisants. Pour Pékin, il s’agit d’imposer un standard mondial façonné en Chine.
Le Maroc, spectateur passif d’un champ de bataille global
Or, dans ce duel titanesque, le Maroc demeure absent. Ni ses acteurs politiques, ni ses élites économiques, ni ses diplomates ne se sont véritablement penchés sur TikTok. Pourtant, les signaux existent : les condamnations de plusieurs tiktokers marocains fin 2024 et et la desinformation massive des réseaux algériens auraient dû alerter sur l’ampleur du phénomène. Plus inquiétant encore, certaines vidéos visant le pays émergent déjà, calquées sur la grammaire virale de la Gen Z, à l’image des campagnes coordonnées observées au Népal.
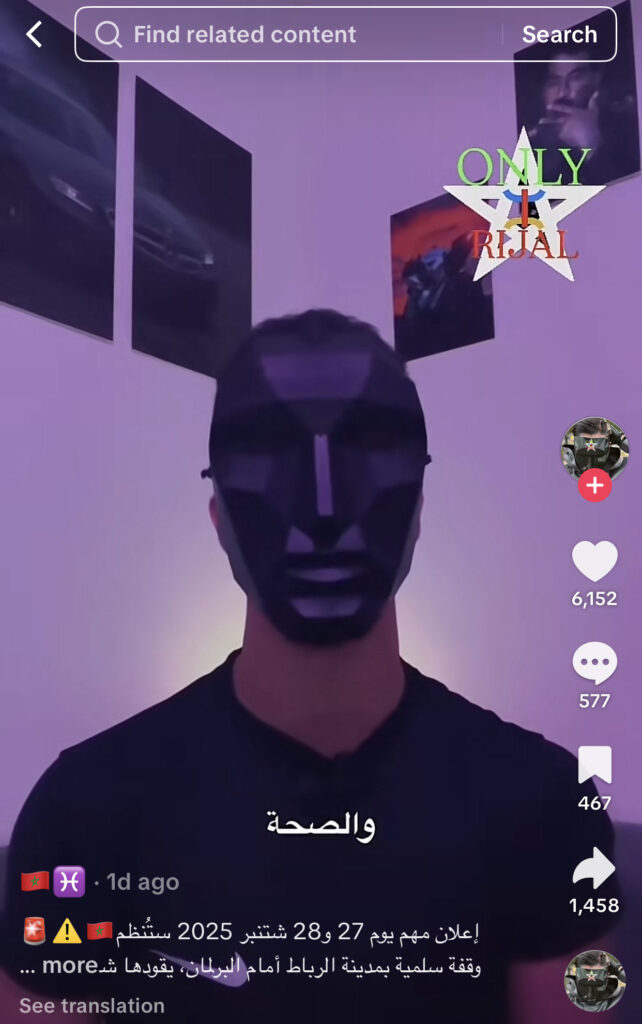
Ne pas investir TikTok, c’est laisser un espace vide que d’autres, plus organisés, s’empresseront d’occuper. C’est renoncer à un levier d’influence qui a contribué à la reconquête de la Maison Blanche par Trump, et qui alimente l’émergence de nouvelles figures politico-médiatiques radicales.
Le précédent népalais : quand TikTok déclenche et entretient la révolte
Au Népal, TikTok a joué un rôle décisif dans l’explosion des manifestations de septembre 2025. Tout est parti de vidéos virales dénonçant le luxe indécent des enfants de l’élite politique, dans un pays où une génération entière se débat avec le chômage et l’exil économique. Ces séquences, brutes et sans filtre, ont suffi à transformer un malaise diffus en un mouvement de rue d’une ampleur inédite depuis deux décennies.
Lorsque le gouvernement a tenté d’étouffer la contestation en imposant un black-out numérique massif – Facebook, WhatsApp, Instagram, X et plus de vingt plateformes réduites au silence – TikTok est resté le seul réseau social accessible. La plateforme chinoise, seule à avoir accepté les conditions de régulation imposées par Katmandou, s’est transformée en canal exclusif de mobilisation, d’organisation et de diffusion des affrontements. L’espace public numérique avait été réduit à une seule application, devenue à la fois catalyseur et caisse de résonance d’une révolte générationnelle.
Dans ce contexte, l’Inde s’est rapidement immiscée dans le récit de la crise, instrumentalisant les images venues de Katmandou pour orienter la perception régionale des événements. Une illustration supplémentaire que TikTok n’est pas seulement un outil culturel : c’est désormais une arme géopolitique, capable de remodeler des équilibres nationaux fragiles et d’attirer les ingérences des puissances voisines.
Un enjeu de souveraineté numérique et de sécurité nationale
Le Maroc ne peut pas rester spectateur. Les grandes puissances se disputent TikTok parce qu’elles ont compris que l’algorithme est devenu un champ de bataille stratégique, culturel et idéologique. Ignorer cette réalité, c’est s’exposer à voir se répéter, une fois de plus, le scénario de l’impuissance numérique.
À l’heure où les États-Unis et la Chine s’arrachent la clé de la viralité mondiale, le Maroc doit décider s’il veut rester à la marge ou investir ce nouvel espace pour protéger sa souveraineté, défendre son récit et influencer, lui aussi, les imaginaires collectifs.





