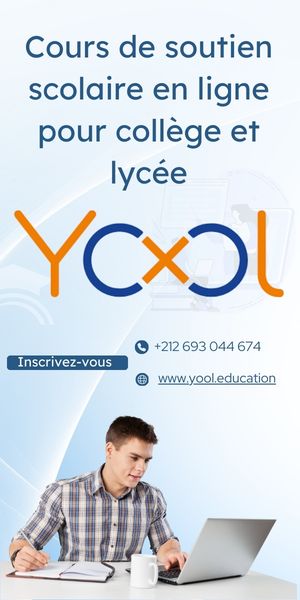Alors que l’Égypte subit de fortes pressions régionales, son paysage médiatique connaît un basculement inédit. Les figures emblématiques de la télévision, longtemps piliers du discours officiel, se rebellent en adoptant un discours de plus en plus critique, en rupture avec la ligne du pouvoir. En parallèle, TikTok, espace d’expression populaire échappant aux canaux traditionnels, est devenu à la fois un défi et une opportunité pour le régime : après avoir lancé début août une rafle visant le top 30 des influenceurs les plus suivis, Le Caire a scellé un partenariat stratégique avec la plateforme chinoise pour tenter de l’intégrer dans son dispositif de communication. Mais derrière cette reprise en main se dessine un enjeu bien plus vaste : un pouvoir en souffrance par une dépendance multiple — hydrique avec l’Éthiopie, énergétique vis-à-vis d’Israël, et financièrement tributaire des mégaprojets soutenus par Riyad et Abou Dhabi — au moment où la guerre de Gaza accélère la reconfiguration stratégique du Moyen-Orient.
Un président sous pressions multiples
Depuis trois mois, Abdel Fattah al-Sissi est soumis à une pression croissante, à la fois interne et externe. L’administration Trump, en particulier, instrumentalise le dossier du barrage de la Renaissance éthiopien pour contraindre Le Caire à infléchir sa position sur Gaza : un chantage hydrique qui touche au cœur de la sécurité nationale égyptienne. À cela s’ajoutent Riyad et Abou Dhabi, bailleurs de fonds des mégaprojets d’infrastructures lancés depuis 2014, qui s’agacent d’une économie exsangue et d’une gouvernance verrouillée. Pris dans cet étau — dépendance financière vis-à-vis du Golfe, vulnérabilité hydrique face à l’Éthiopie et dépendance énergétique à Israël — al-Sissi doit affronter une nouvelle faille : la perte progressive de contrôle sur le front médiatique et numérique, désormais impossible à contenir dans les seuls talk-shows télévisés.
La fissure du verrouillage télévisuel
Le verrouillage médiatique qu’il pensait total vacille. Les animateurs et éditorialistes qui furent ses relais lors de la chute des Frères musulmans en juin 2013 s’autorisent aujourd’hui une critique inédite du régime. Ibrahim Issa, qui avait été l’un des premiers à interviewer al-Sissi, s’impose désormais comme une voix dissidente aussi critique que les chaînes de l’opposition exilée en Turquie ou à Londres. Amr Adib, journaliste vedette naturalisé saoudien, est allé jusqu’à accuser les conglomérats médiatiques contrôlés par les services de renseignement — dirigés par Mahmoud al-Sissi, fils du président — de provoquer la rupture avec Riyad.
Une purge médiatique et la colère du Golfe
L’éloignement de figures emblématiques comme Lamis El Hadidi, Khairy Ramadan et Ibrahim Issa a stupéfié l’opinion. Ces voix critiques, pourtant intégrées au système, ont été limogées des médias publics ou marginalisées. En toile de fond, une détérioration des relations avec Riyad, marquée par des attaques médiatiques inédites : fuites de documents, campagnes coordonnées sur les réseaux et une rhétorique saoudienne laissant entendre que le règne de Sissi pourrait s’achever d’ici 2026.

Le clash autour du divertissement illustre ce désalignement. Quand Turki al-Sheikh, patron du divertissement saoudien, a annoncé l’exclusion des artistes égyptiens du festival de Riyad, Amr Adib a soutenu la décision, accusant directement les conglomérats égyptiens d’avoir « saboté » l’image du royaume. Un signe fort : l’Égypte, jadis exportatrice de soft power vers le Golfe, devient aujourd’hui dépendante de ses arbitrages culturels et financiers.
Pour faire face à ces attaques, Abdel Fattah al-Sissi a convoqué, le 10 août, ses principaux responsables du secteur médiatique. À l’issue de la réunion, la présidence a annoncé une “feuille de route pour réformer l’audiovisuel et la presse”, censée renforcer la liberté d’expression, diversifier les points de vue et promouvoir de jeunes talents. Sur le papier, le discours insiste sur la pluralité, l’ouverture et la modernisation de “Maspero”, l’iconique complexe de radio-télévision. Dans les faits, il s’agit d’une recentralisation entre les mains des services et du cercle rapproché du président.
TikTok, nouvel ennemi intérieur
La réaction du pouvoir à cette perte de contrôle est révélatrice. Constatant que la rue égyptienne échappait aux talk-shows traditionnels, le régime a ciblé le réseau social le plus en vogue, TikTok. Début août, une vaste purge a conduit à l’arrestation des trente influenceurs les plus suivis de la plateforme, accusés de “pudeur offensée” et de “blanchiment d’argent”. Tous venaient des quartiers défavorisés, où leurs vidéos cumulaient des millions de vues et généraient des revenus considérables. Car TikTok, offre la rémunération de Youtube et la viralité d’entant de Facebook.
En effet, contrairement à YouTube, le réseau chinois offre des mécanismes de monétisation plus rapides et plus rémunérateurs, transformant en quelques mois des jeunes issus de milieux populaires en véritables célébrités digitales. Leur contenu, souvent marqué par une esthétique plus crue, tranche avec les formats policés d’Instagram et de la télévision officielle et séduit une génération frustrée par la pauvreté et l’absence de perspectives. C’est cette combinaison — argent, audience et codes culturels nouveaux — qui a fait de TikTok un espace de liberté incontrôlable aux yeux du pouvoir, et donc une cible prioritaire de la répression.
Trois semaines plus tard, retournement spectaculaire : la même “United Media Services” annonçait un partenariat stratégique avec TikTok. Objectif affiché : “reformuler le contenu” et “l’adapter aux valeurs locales”. En clair, intégrer la plateforme dans la machinerie de communication du régime. Les analystes y voient moins un projet éditorial qu’une tentative de neutraliser un canal perçu comme ingérable, et potentiellement exploitable par des puissances étrangères dans le contexte explosif de Gaza.
La « tenaille eau-gaz » : dépendance existentielle
Au-delà de la bataille médiatique, l’Égypte est prise dans une tenaille géostratégique qui met en jeu ses deux ressources vitales : l’eau et le gaz.
- L’eau : le Grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, conçu dès les années 1950 par des études américaines et légitimé par un accord de principes signé avec l’appui d’Abou Dhabi et d’Israël, place Le Caire face à une menace existentielle. Chaque mètre cube retenu à Addis-Abeba fragilise le quota historique de 55,5 milliards m³ du Nil, colonne vertébrale de la vie en Égypte.
- Le gaz : en août 2025, Israël a signé avec Le Caire le plus grand contrat gazier de son histoire : 35 milliards $, soit 130 milliards m³ de gaz fournis à l’Égypte jusqu’en 2040. Les livraisons, qui représentent déjà 15 à 20 % de la consommation égyptienne, vont tripler à l’horizon 2029. Officiellement, l’accord fait de l’Égypte un hub énergétique régional ; en réalité, il l’enferme dans une dépendance structurelle à Tel-Aviv, qui conserve le robinet.
Ce double verrou énergétique et hydrique illustre une fragilité unique : le fleuve du pays est contrôlé en amont par l’Éthiopie, son électricité dépend en aval du gaz israélien. Dans un Moyen-Orient en recomposition, cette situation transforme l’Égypte en acteur contraint, obligé de composer avec des partenaires qui détiennent ses leviers de survie.
Les avertissements de l’intérieur
Le constat ne vient plus seulement des opposants exilés. Hossam Badrawi, dernier secrétaire général du Parti national démocrate sous Hosni Moubarak, a publié un texte d’une rare virulence. Il dénonce “une comédie électorale sans pluralisme”, “une opposition fabriquée sur mesure” et “un retour du religieux par les arrière-portes du pouvoir”. Pour lui, la mécanique est identique à celle qui avait mené à l’explosion de 2011 : verrouillage, déni et reproduction des erreurs.
L’analyse de l’expert Robert Springborg éclaire cette équation : l’armée, pivot du régime, est devenue une puissance économique plus préoccupée par ses profits que par la défense nationale. Elle contrôle l’essentiel des grands secteurs, du ciment aux infrastructures, et capte les flux financiers liés aux guerres voisines, notamment au Soudan. Ce militaro-capitalisme alimente une polarisation extrême : une élite consommatrice et enrichie d’un côté, des millions de laissés-pour-compte de l’autre.
Égypte dans la reconfiguration régionale
La situation égyptienne ne renvoie plus au spectre de 2011, mais à une reconfiguration géopolitique d’ampleur. Alors que se dessine la vision d’un « Grand Israël » appuyé par des alliances énergétiques et sécuritaires régionales, l’Égypte d’al-Sissi apparaît fragilisée. Dépendante de l’eau contrôlée par l’Éthiopie, du gaz israélien et des financements du Golfe, elle tente de compenser par une reprise en main médiatique, allant jusqu’à capter TikTok. Mais ce contrôle des récits ne masque pas la réalité : Le Caire évolue désormais en marge d’un nouvel ordre moyen-oriental, où ses leviers stratégiques sont réduits et ses vulnérabilités mises à nu.